| 1839 30 Novembro | LE MAGASIN PITTORESQUE 7º Ano Nº. 47 Pag. 374, 375, 376 |
LA PHOTOGRAPHIE,
OU LE DAGUERRÉOTYPE
Parmi les inventions qui depuis le commencement de ce siècle ont excité un intérêt universel; celle du Daguerréotype est certainemënt l’une des plus extraordinaires. Pendant long-temps elle a été entourée d’un mystère favorable à l’incrédulité; mais l’admiration seule maintenant est permise. L’Etat, qui vient d’en acquérir la proprieté dans l’intérêt des sciences et des arts, a donné le signal de la publicité; c’est donc un devoir en quelque sorte pour les organes de la presse de porter la découverte de M. Daguerre à la connaissance du plus grand nombre possible de personnes, et de populariser ses procédés, pour que les esprits curieux et ingénieux soient en tous lieux appelés a en jouir, et à se mettre sur la voie des perfectionnements.
Pour bien comprendre la photographie, il est nécessaire d’avoir préalablement quelque notion de la chambre noire, qu’on appelle aussi chambre obscure. Voici comment M. Arago raconte l’histoire de cette derniere invention.
Un physicien napolitain, Jean-Baptiste Porta, reconnut, il y a environ deux siècles, que si l’on perce un très petit trou dans le volet de la fenetre d’une chambre bien close, ou, mieux encore, dans une plaque métallique mince appliquée à ce volet, tous les objets extérieurs dont les rayons peuvent atteindre le trou vont se peindre sur le mur de la chambre qui lui fait face, avec des dimensions reduites ou agrandies suivant les distances, et avec les couleurs naturelles. Porta decouvrit, peu de temps après, que le trou n’a nullement besoin d’être petit; qu’il peut avoir une largeur quelconque quand on le couvre d’un de ces verres bien polis qui, à raison de leur forme, ont eté appelés des lentilles.
Dès lors Porta fit construire des chambres noires portatives. Chacune d’elles etait composée d’un tuyau plus ou moins long armé d’une lentille; l’écran blanchâtre en papier ou en carton, sur lequel les images allaient se peindre, occupait le foyer. Cet appareil a été depuis perfectionné: une glace dépolie remplace l’éran blanchâtre, et sur cette glace la lumière trace des vues parfaitement exactes des objets les plus compliqués avec netteté parfaite de contours, avec la dégradation naturelle des teintes. Mais on sait que ces images sont fugaces comme les reflets, comme l’ombre; dès qu’on déplace l’appareil, dès qu’on enlève la glace, elles disparaissent.
Or ce sont ces images de la chambre obscure qui, par la découverte de M. Dagucrre, s’impriment maintenant elles-mêmes sur une surface métallique qui remplace le verre dépoli, et, une fois produites et fixées, elles se conservent pour toujours. En d’autres termes, dans le Daguerréotype, la puissance de la lumière crée, en quatre on cinq minutes, des dessins ou les objets conservent mathématiquement leurs formes jusque dans les plus petits détails, où les effets de la perspective linéaire, et la dégradation des tons provenant de la perspective aérienne, sont accusés avec une delicatesse que l’art n’a jamais connue.
Ainsi nul doute, nulle ambiguité. Une personne qui ignore completement le dessin peut, à l’aide du Daguerréotype, obtenir en quelques minutes des images parfaites et durables de tous les objets ou de toutes les vues qui lui plaisent. Il lui suftit de placer l’appareil devant un paysage, devant un monument, devant une statue, ou dans sa chambre devant les curiosités ou les tableaux qui l’ornent, et en quelques instants il en a la reproduction parfaite: il a un dessin qu’il encadre, qu’il met sous verre, qu’il suspend a la muraille comme une estampe qui aurait été executée lentement, patiemment et à grands frais. Chacun peut, avec cette admirable invention, s’entourer de tous les souvenirs qui lui sont chers; avoir une représentation fidèle de sa maison paternelle, des lieux ou il a vécu, ou qu’il a admirés dans ses voyages.
On s’exposerait toutefois à une sorte de déception si l’on imaginait que toute image de la nature obtenue par le moyen du Daguérreotype est nécessairement une œuvre d’art remarquable, une estampe belle et séduisante. D’abord, tous les objets et toutes les vues de la nature ne sont pas agréables; il faut savoir choisir. Puis, dans les épreuves du Daguerréotype, les images se reproduisent sans leurs couleurs: on croirait voir des dessins à la manière noire, ou plutôt à la mine de plomb estompée; ce ne sont pas des tableaux. Enfin, il faut tout dire; dans l’état actuel de l’invention, la lumière de l’image n’a pas encore toute la vivacité, toute la chaleur de la lumiére du jour. L’effet est le plus ordinairement froid et sombre comme s’il était donné par un crépuscule d’hiver: le soleil semble absent; on croirait an plus que la lune était au ciel tandis que se formait dans la chambre obscure le dessin mystérieux. Aussi nous confesserons quelles plus blles épreuves du Daguerréotype que nous ayons encore vues sont celles qui représentaient, soit des monuments d’une architecture riche et fleurie saisis dans des conditions favorables, soit des interieurs de cabinets d’art où se trouvaient des bas-reliefs, des statuettes, des médailles, des objets precieux, groupés avec intention et avec goût. Ces derniers sujets sont reproduits avec une perfection et un charme a désesperer les plus habiles disciples de Gerard Dow, de Mieris ou de Metzu.
Malgré ces restrictions, la découverte est admirable, et on l’eût regardée autrefois comme un miracle ou comme un sortilége. Ce n’est point par le hasard qu’elle à été produite, mais par la force de la volonté, et après quinze ans de veilles et de tâtonnements. Essayons en partie de l’expliquer, nous aidant du rapport lu par M. Arago à la Chambre des députés, et de la communication qu’il a faite depuis à l’Académie des sciences.
Les alchimistes réussirent jadis à unir l’argent à l’acide marin; le produit de la combinaison était un sel blanc qu’ils appelèrent lune ou argent corné. Ce sel jouit de la propriété remarquable de noircir à la lumière, de noircir d’autant plus vite que les rayons qui le frappent sont plus vifs. Couvrez une feuille de papier d’une couche d’argent corné, ou, comme on dit aujourd’hui, d’une couche de chlorure d’argent; formez sur cette couche, à l’aide d’une lentille, l’image d’un objet: les parties obscures de l’image, les parties sur lesquelles ne frappe aucune lumière resteront blanches; les parties fortement eclairées deviendront complétement noires; les demi-teintes seront représentées par des gris plus ou moins foncés.
Ces applications de la curieuse propriété du chlorure d’argent découverte par les anciens alchimistes, ont préoccupé, au commencement de notre sièc,e; plusieurs savants illustres, entre autres notre célebre physicien Charles, Wedgwood (voy. p. 93), et Humphry Davy. Mais il était réservé à nos compatriotes MM. Niepce et Daguerre de féconder ces essais et d’en faire sortir la découverte.
M. Niepce était un proprietaire retiré dans les environs de Châlons-sur-Saône. Il consacrait ses loisirs a des recherches scientifiques. Il paraît s’être occupé dès 1814 des moyens de fixer les images de la chambre obscure. Plus tard, il unit ses efforts à M. Daguerre, qui fit des progrés plus rapides vers la découverte, et qui, après la mort de son associé, survenue il y a quelques années, acheva de lui donner le caractére précis qu’elle a maintenant. Une correspondance authentique entre ces deux physiciens ne permet pas en effet de douter que, par la supériorité de sa méthode, par le meilleur choix des enduits, M. Daguerre n’ait plus particulièrement droit au titre d’inventeur.
Voici la description du procédé employé par M. Daguerre.
Les épreuves se font sur des feuilles d’argent plaquées sur cuivre. L’épaisseur des deux métaux ne doit pas excéder celle d’une forte carte.
Le procédé se divise en cinq operations : - la première consiste a polir et à nettoyer la plaque pour la rendre propre à recevoir la couche sensible sur laquelle l’image doit se fixer; - la seconde, à appliquer cette couche; - la troisième, à soumettre, dans la chambre noire, la plaque préparrée à l’action de la lumière pour y recevoir l’image de 1a nature; - la quatriéme, à faire paraître cette image qui n’est jamais visible en sortant de la chambre noire; - Ia cinquième a pour but d’enlever la couche sensible qui continuerait a être modifiée par la lumière et tendrait à détruire 1’épreuve.
Première opération.- Il faut pour cette opération: un petit flacon d’huile d’olives, du coton carde très fin, de la ponce broyée excessivement fine, enfermée dans un nouet de mousseline assez claire pour que la ponce puisse passer facilement en secouant le nouet; un flacon d’acide nitrique étendu d’eau dans la proportion d’une partie (en volume) d’acide, contre seize parties (également en volume) d’eau distillée; un châssis en fil de fer sur lequel on pose les plaques pour les chauffer à l’aide d’une lampe à esprit-de-vin; enfin une petite lampe à esprit-de-vin.
On commence par bien polir la plaque; à cet effet on la saupoudre de ponce (en secouant sans toucher la plaque), et avec du coton imbibé d’un peu d’huile d’olives, on la frotte légèrement en arrondissant. Quand la plaque est bien polie, il s’agit de la dégraisser, ce qui se fait encore en la saupoudrant de ponce et en la frottant à sec avec du coton, toujours en arrondissant. On fait ensuite un petit tampon de coton qu’il faut imbiber d’un peu d’acide étendu d’eau. Alors on frotte la plaque avec le tampon, en ayant soin d’étendre parfaitement l’acide sur toute la surface de la plaque. On s’aperçoit que l’acide est bien également etendu lorsque la surface de la plaque est couverte d’un voile régulier sur toute son étendue. Ensuite on saupoudre la plaque de ponce, et, avec du coton qui n’a pas servi on la frotte tres légèrement.
Alors la plaque doit être soumise à une forte chaleur; on la place sur le chassis de fil de fer, et on promène dessous la lampe à l’esprit-de-vin jusqu’à ce qu’il se forme à la surface de l’argent une légère couche blanchâtre. On fait ensuite refroidir promptement la plaque en la placant sur un corps froid, tel qu’une table de marbre. Lorsqu’elle est refroidie, il faut la polir de nouveau, c’est-a-dire enlever la couche blanchâtre. Lorsque l’argent frotté à sec avec le tampon est bien bruni, on le frotte avec l’acide étendu d’eau, et on le saupoudre de nouveau d’un peu de ponce en frottant très légèrement avec un tampon de coton. Il faut eviter la vapeur humide de l’haleine, ainsi que les taches de salive et le frottement des doigts.
Deuxième opération. - Pour cette operation, il faut la planchette fig. t1 (p. 376), la boîte fig. 2, et un flacon d’iode. Après avoir fixé la plaque sur une planchette au moyen de bandes métalliques et de petits clous, comme elle est indiquée figure 1, il faut mettre de l’iode divisé dans la capsule qui se trouve au fond de la boîte. On place la planchette, le métal en dessous,sur les petits goussets placés aux quatre angles de la boîte dont on ferme le couvercle. Dans cette position, il faut la laisser jusqu’à ce que la surface de l’argent soit couverte d’une belle couche jaune d’or. II est indispensable de regarder de temps en temps pour s’assurer si elle atteint le degré de jaune nécessaire; mais la lumière ne doit pas frapper directement dessus. Aussi faut-il mettre la boîte dans une pièce obscure où le jour n’arrive que très faiblement, et lorsqu’on veut regarder la plaque, après avoir ôté le couvercle de la boîte, on prend la planchette par les extrémités avec les deux mains, et on la retourne promptement; il uffit alors que la plaque réfléchisse un endroit peu éclairé et autant que possible éloigné pour qu’on s’aperçoive si la couleur jaune est assez foncée. On remet très promptement la plaque sur la boîte si la couche n’a pas atteint le ton jaune d’or; si, au contraire, cette teinte était dépassée, la couche ne pourrait pas servir, et il faudrait recommencer entièrement la première opération. Lorsque la plaque est arrivée au degré de jaune nécessaire, il faut emboîter la planchette dans un châssis, comme il est indiqué dans la figure 5. Le jour ne doit pas frapper sur la planche; tout au plus peut-on se servir d’une bougie. On passe ensuite à la troisieme opération. Si l’intervalle entre la deuxième et la troisiéme operation était de plus d’une heure, la combinaison de l’iode et de l’argent n’aurait plus la même proprieté.
Troisième opération. - L’appareil nécessaire à cette opération se borne à la chambre noire figure 4. On place la boîte de la chambre noire devant la vue que l’on veut reproduire, en choisissant de préference les objets eclairés vivement par le soleil. Les moments les plus favorables sont entre sept heures du matin et trois heures après midi. Après avoir placé convenablement la chamhre obscure, il est essentiel de bien mettre au foyer, c’est-à-dire de reculer ou avancer la double boîte BB de l’appareil jusqu’à ce que l’image de la nature apparaisse en traits parfaitement distincts sur la glace depolie A. Lorsqu’on a atteint une grande précision, on remplace cette glace dépolie par le châssis figure 3, et on en ouvre les portes AA de manière à ce quela couche d’iode recoive l’impression de la vue ou des objets que l’on a choisis. Il ne reste plus alors qu’a ouvrir le diaphragme E et à laisser agir la nature.
Cette opération est très delicate; et l’on n’y réussit qu’après avoir acquis une certaine expérience. En effet, il est de toute impossibilité de déterminer le temp necessaire à la reproduction, puisqu’il depend entièrement de l’intensité de lumière des objets que l’on veut reproduire, et que l’action de cette lumière est complétement invisible. Cependant il est très important de ne point dépasser le temps nécessaire pour la reproduction, parce que les clairs ne seraient plus blancs; ils seraient noircis. Si, au contraire, le temps n’était pas suffisant, l’épreuve serait vague et sans details. Ce temps peut varier pour Paris de trois on quatre minutes aux mois de juin et de juillet, et de cinq ou six minutes dans les mois de mai et d’août, de sept à huit en avril et en septembre, et ainsi de suite dans la même proportion, à mesure qu’on avance dans la saison. Ceci n’est, du reste, qu’une donnée générale pour les objets très éclairés; car il arrive souvent qu’il faut vingt minutes dans les mois les plus favorables, lorsque les objets sont entiérement dans la demi-teinte.
Quatrième opération. - Il faut pour cette opération l’appareil fig. 5, un flacon de mercure contenant au moins un kilo, une lampe à l’esprit-de-vin, un entonnoir. La plaque, lorsqu’on la retire de la chambre noire, a conservé sa teinte uniforme de jaune d’or, et semble n’avoir subi aucune modification. L’empreinte de l’image de la nature existe sur la plaque; mais elle n’est pas visible. Il s’agit, dans la quatrième opération, de la rendre visible. C’est pourquoi l’on transporte subitement la plaque dans la boîte (fig. 5), où, placée sur des lasseaux qui la tiennent inclinée à 45 degrés, elle est exposée (A) à un courant ascendant de vapeur mercurielle qui s’élève d’une capsule (B) dans laquelle le liquide est monté par l’action d’une lampe à esprit-de-vin (C). Catte vapeur s’attache en abondance aux parties de la surface de la plaque qu’une vive lumière a frappées; elle laisse intactes les régions restées dans l’ombre; enfin elle se précipite sur les espaces qu’occupaient les demi-teintes. Un verre adapté à la boîte (P) permet de suivre du regard, à faible lumière d’une bougie, la formation graduelle de l’image. On voit la vapeur mercurielle, comme un pinceau de la plus extrême délicatesse, marquer du ton convenable chaque partie de la plaque.
Un thermomètre adapté à la boîte indique le moment où l’on doit retirer la lampe à esprit-de-vin; c’est 1orsqu’il marque 60 degrés centigrades. En général, il faut laisser la plaque dans l’appareil jusqu’à ce que le thermomètre soit descendu à 46 degrés, quelquefois auparavant si la lumière a été très vive.
Cinquième opération. - L’image est alors reproduite; mais il faut empêcher que la lumière du jour ne l’altère. On arrive à ce résultat en agitant la plaque dans de l’eau saturée de sel marin, ou dans une solution d’hyposulfite de soude, et en la lavant ensuite avec de l’eau distillée chaude. Après ce lavage qui exige beaucoup de précautions, l’épreuve est terminée. Il ne reste plus qu’à préserver la plaque de la poussière et des vapeurs qui pourraient tenir l’argent. Le mercure qui dessine les images est en partie décomposé; il adhère à l’argent, il réiste à l’eau qu’on verse dessus; mais il ne peut soutenir aucun, frottement. Pour conserver les épreuves, il faut les mettre sous verre et les coller; elle sont alors inaltérables, même au soleil.
(Daguerréotype. - Fig,1.)
A Feuille d’argent plaqué fixée sur une planchette au moyen de quatre petites bandes B B B B en argent plaqué, de même épaisseur que la plaque. On fixe ces bandes avec de petits clous; elles retiennent la plaque par de petiles saillies sondées dessus. Leur utilité est de faciliterl’égalisation de la couche d’iode, qui sans elles serait beaucoup plus intense sur les bords de la plaque que dans le centre.
(Fig. 2.- Coupe de la bolte qui sert à fixer la couche d’iode sur la feuille d’argent plaqué.)
A Planchette garnie de la plaque (comme elle est désignée fig. 1). Elle se pose, pour obtenir la couche, sur les goussets B qui sont aux quatre angles de la boite. - C Couvercle qui, avant que l’on n’opére, ferme parfaitement la partie inférieure de la boîte, et sert à concentrer l’évaporation de l’iode. On l’enlève au moment où l’on place la planchette sur les goussets.- D Capsule dans laquelle on dépose l’iode. - EE Cercle garni de gaze, que l’on pose sur la capsule pour égaliser la vapeur de l’iode et pour empècher qu’il ne s’en détache des parcelles. - F Couvercle de la boîte, qui doit toujours rester fermée. - GGGG Garniture en bois formant dans l’intérieur une seconde boîte en forme d’entonnoir.
( Fig. 3. - Châssis dans lequel est renfermée la planchette garnie de la plaque, pour la garantir de la lumiére, aussitôt qu’elle a reçu la couche d’iode dans la boîte fig. 2. On n’ouvre plus les portes de ce châssis AA de manière à découvrir la planchette qu’après l’avoir mis, à la place de la glace dépolie, dans la chambre noire.)
(Fig. 4. – Chambre noire.)
A Glace dépolie qui reçoit l’image de la nature. On l’avance ou on la recule, avec la double boite B à laquelle elle est attachée, pour bien mettre au foyer, c’est-a-dire pour obtenir que les objets dont on désire fixer l’image se reproduisent sur la glace avec une grande netteté. Ensuite on remplace la glace par le châssis contenant la plaque fig. 3. - C Miroir qui sert à redresser les objets, et qu’on incline à 45 degrés, tandis que 1’on cherche le poin de vue.- D Objectif achromatique et périscopique (la partie concave doit être en dehors de la chambrc noire). Son diamétre est de 81 millimètres, et son foyer de 38 centimètres. - E Diaphragme placé en avant de l’objectif, à une distance de 68 millimètres.
 (Fig. 5. - Appareil dans lequel on enferme la plaque, après l’avoir retirée avec son châssis de la chambre noire, pour la soumettre à l’action de la vapeur mercurielle.)
(Fig. 5. - Appareil dans lequel on enferme la plaque, après l’avoir retirée avec son châssis de la chambre noire, pour la soumettre à l’action de la vapeur mercurielle.)
A La plaque avec la planchette enfermée dans une planche noire à rainures, et posée sur des tasseaux qui ta tiennent inclinée à 45 degrés; le métal placé en dessous. - B Capsule contenant le mercure. – C Lampe à l’esprit-de-vin. - D Glace à travers laquelle on peut voir l’mage de la nature apparaître peu à peu sur la plaque à mesure que monte et agit la vapeur mercurielle. – E Couvercle de l’appareil. - Cet appareil est garni intérieurement d’on thermomètre F dont la boule plonge dans le mercure, et d’un robinet par lequel on retire le mercure. Tout l’intérieur de l’appareil doit être en noir verni.
Ajoutons que le moyen de convertir les épreuves du Daguerréotype en planches gravées vient d’etre découvert. Ainsi chaque dessin obtenu par les procédés que nous venons d’indiquer pourra êre reproduit, comme toute espèce de gravure, à un nombre considérable d’exemplaires.




 Photographie : Fig. 1. – Cabinet laboratoire pour la production des surfaces sensibles
Photographie : Fig. 1. – Cabinet laboratoire pour la production des surfaces sensibles Fig. 2. - Cabinet laboratoire pour le fixage.
Fig. 2. - Cabinet laboratoire pour le fixage.
 chambre (fig. 4); de cette maniére, on n’admet sur la glace dépolie d’autre lumière que celle qui vient de l’intérieur et traverse l’objectif; l’image apparaî alors dans tout son éclat, et la mise exacte au point est plus facile et plus précise.
chambre (fig. 4); de cette maniére, on n’admet sur la glace dépolie d’autre lumière que celle qui vient de l’intérieur et traverse l’objectif; l’image apparaî alors dans tout son éclat, et la mise exacte au point est plus facile et plus précise. Fig. 7. – Point de vue trop en dessous
Fig. 7. – Point de vue trop en dessous Fig. 8. – Point de vue trop en dessus
Fig. 8. – Point de vue trop en dessus
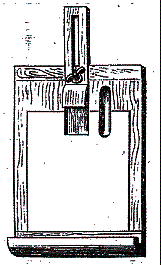 Fig. 10. – Chassis à nettoyer les glaces
Fig. 10. – Chassis à nettoyer les glaces


